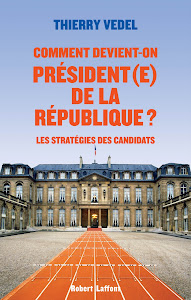Mener une action politique, c’est aussi savoir communiquer. Pour sensibiliser l’opinion, mobiliser des soutiens et inscrire un problème sur l’agenda gouvernemental, les acteurs sociaux doivent mener des actions de communication, et surtout savoir capter l’attention des médias.
Mener une action politique, c’est aussi savoir communiquer. Pour sensibiliser l’opinion, mobiliser des soutiens et inscrire un problème sur l’agenda gouvernemental, les acteurs sociaux doivent mener des actions de communication, et surtout savoir capter l’attention des médias.
Faire ce constat peut sembler relever de l’évidence. Pourtant, jusqu’à la fin des années 1970, les groupes contestataires avaient tendance à se méfier des médias, perçus comme la composante idéologique d’un appareil d’Etat répressif (pour reprendre le vocabulaire de l’époque). Depuis une vingtaine d’années au contraire, de nombreuses associations ou groupements politiques considèrent les médias comme un instrument de leur combat. Greenpeace, Act Up, Droit au Logement ou, plus récemment, le mouvement alter-mondialisation ont su ainsi concevoir des stratégies de communication sophistiquées pour séduire les médias et donner un plus large écho à leurs revendications.
Le campement citoyen organisé le long du canal Saint-Martin par l’association Les Enfants de Don Quichotte illustre à merveille ce type de stratégie. Après une première tentative pour installer un premier campement sur la Place de la Concorde le 3 décembre 2006, l’association a monté une centaine de tentes le 16 décembre entre le 100 et le 140 du Quai de Jemmapes «pour attirer l’attention de la population sur la situation des sans-logis ».
En quelques semaines, cette opération a non seulement capté l’attention des médias, mais conduit le Premier ministre, Dominique de Villepin, à annoncer, le 3 janvier 2007, un projet de loi ayant notamment pour but de formaliser le droit au logement.
Mais pourquoi cette opération là a-t-elle mieux réussi que d’autres ? Il y a plus d’un an, Médecins du monde lançait l’opération A défaut d’un toit, une toile de tente , « pour rendre plus visibles celles et ceux qu’on ne veut plus voir et pour sortir des solutions d’urgence qui n’en sont pas. L’association a distribué en un an plus de 400 tentes, mais sans réussir à provoquer la mobilisation des politiques qu’on constate aujourd’hui. Certes, en juillet 2006, la ministre déléguée à la Cohésion sociale, Catherine Vautrin, nommait une médiatrice, Agnès de Fleurieu, présidente de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale pour dresser un état de la situation et formuler des solutions. Mais, l’installation des tentes était très critiquée et, à Paris, a suscité l’hostilité de certains riverains tandis que la municipalité s’attachait à les faire disparaître, « de façon humaine mais ferme ».
Les ingrédients d'un succès (médiatique)
Sur un plan communicationnel, l’opération des Enfants de Don Quichotte présente plusieurs
éléments qui ont contribué à son succès.
- une association au nom bien trouvé : Don Quichotte pour évoquer les combats chevaleresques et désespérés contre les institutions et les pouvoirs établis, mais enfants pour signifier qu’on ne fait pas « les mêmes erreurs que papa-maman » (d’après Le Figaro du 27 décembre 2006)
- le choix du moment: la période de Noël est évidemment plus propice que d’autres à la compassion envers ceux qui n’ont pas de maison; l’activité politique est ralentie et les médias moins encombrés par les déclarations des responsables politiques.
- le choix du site : comme l’écrit
Pierre Haski dans le Libération du 27 décembre, « en agissant (…) dans un quartier en passe de devenir le cœur du boboland parisien, les Enfants de Don Quichotte ont touché efficacement la mauvaise conscience des nantis relatifs à l’heure du consumérisme triomphant de Noël.» De fait, l’opération a reçu un bon accueil de la part du voisinage contrairement à ce qui s’était passé pour les tentes de Médecins du monde.
La proximité du canal devrait de plus empêcher toute intervention policière (par peur d’une noyade dans les eaux glacées).
Enfin, ce site a permis une installation spectaculaire : l’alignement des tentes le long du canal, l’uniformité de leur modèle et leur couleur dominante rouge (qui évoque à la fois Noël et la révolte et créé un effet de masse) fournissent de belles images aux médias,
comme celles réalisées par Laurent Hazgui.
- l’utilisation d’un terme bizarre, le droit au logement opposable, qu’on comprend mal de prime abord (et qui sur le plan juridique est assez curieux car si un droit est reconnu par la législation il peut nécessairement être invoqué devant un tribunal) a singularisé l’opération.
- un leader médiatique, comédien de profession, au physique idoine qui est ce que les médias appellent un bon client et passe bien à la télé.
Lorsqu’on consulte le site internet de l’association Les Enfants de Don Quichotte, on constate d’ailleurs que celle-ci accorde une très grande importance aux médias. On y trouve une photothèque, une videothèque, une revue de presse et même une rubrique intitulée Zapping télé. En revanche, on n’y trouve rien sur les statuts de l’association, son mode de fonctionnement, son financement et la composition de son bureau.
Mettre en scène l'obscène?
 On peut défendre la médiatisation, voire la spectacularisation, des causes sociales, comme le fait Sébastien Thiery, chargé de recherche à l'Institut de design de Zurich, dans cet article "SDF: mettre en scène l'obscène", paru dans le Libération du 25 décembre 2006.
On peut défendre la médiatisation, voire la spectacularisation, des causes sociales, comme le fait Sébastien Thiery, chargé de recherche à l'Institut de design de Zurich, dans cet article "SDF: mettre en scène l'obscène", paru dans le Libération du 25 décembre 2006.
Quelle que soit la justesse de la cause, l'opération des Enfants de Don Quichotte suscite néanmoins quelques interrogations :
- Quelle est la légitimité d’une association comme Les Enfants de Don Quichotte, alors que bien d’autres associations soutiennent les SDF depuis de très nombreuses années et ont formulé depuis longtemps les revendications que les Enfants de Don Quichotte mettent en avant? Qu’apporte-t-elle au delà de sa capacité à savoir intéresser les médias ?
- N’y-a-t-il pas instrumentalisation de ceux qu’on dit défendre, momentanément transformés en chair à médias, et oubliés dès que le sujet n’est plus dans l’actualité ? Le directeur général de France Terre d’Asile s’est ainsi inquiété d’un « SDF show » qui crée plus de bruit qu’il ne s’attaque aux causes profondes de la pauvreté. Suite à l’extension de l’opération parisienne des Don Quichotte dans plusieurs villes de province, Sébastien Guth, chargé de la communication à l’association Notre-Dame des Sans Abris de Lyon, a dénoncé quant à lui le 2 janvier 2007 « un coup médiatique sans rien derrière, qui n'aborde pas la question de l'accompagnement social ».
En tant que citoyens, nous nous méfions à juste titre des opérations de communication gouvernementale destinées à nous "vendre" telle ou telle politique publique. De la même façon les responsables gouvernementaux et politiques ne doivent-ils pas se méfier d’opérations de communication citoyennes jouant de l’émotion ?
Car les responsables politiques doivent s’efforcer de traiter l’ensemble des problèmes sociaux et non pas seulement ceux qui sont portés par des entrepreneurs politiques, capables de mobiliser médiatiquement (et temporairement) l’opinion publique.
« Regardez plutôt, Seigneur, tous ceux qui vous attendent… tous ceux qui ont faim de pain, faim de chaleur, faim d’amitié…, tous ceux à qui l’on cache le soleil, ceux à qui l’on marchande l’air qu’ils respirent… tous ceux-là, Seigneur, à qui l’on arrache le nom d’homme, que l’on bafoue, que l’on trompe…, que l’on jette à l’ornière et qui vous tendent leurs mains… Ne les apercevez-vous pas ? … N’entendez-vous plus leurs appels ? … Mon maître ! … il faut y aller… Qui sauvera le monde si Don Quichotte l’abandonne ? »
(Sancho à Don Quichotte dans la scène finale de l'adapation d'Yves Jamiaque)











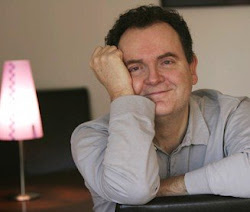%40claire+Garate+-+Copie.jpg)